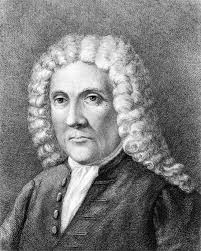Le délicat dilemme des restitutions
Une œuvre d’art ancienne, un vestige archéologique ou un artéfact du passé est-il la propriété immanente et éternelle du pays d’où il est originaire ? Cette question complexe nourrit depuis longtemps de nombreuses querelles diplomatiques et juridiques, qui mobilisent chancelleries et musées. En effet, dès qu’il s’agit d’éléments de première importance pour leur histoire et leur culture, de nombreux États, mais également des communautés et des ethnies, réclament à cor et à cri la restitution de “biens culturels” dont ils estiment avoir été spoliés, en revendiquant d’en être les légitimes propriétaires. Face à ces demandes croissantes, l’Unesco a créé, en 1978, un comité intergouvernemental chargé “de promouvoir la coopération multilatérale et bilatérale en vue de la restitution et du retour de biens culturels à leur pays d’origine”.
Les musées qui détiennent ces œuvres envisagent rarement avec enthousiasme la perspective de voir leur fonds amputé de l’un de ses fleurons, voire même de toute une partie de sa collection. Ces institutions se défendent souvent en faisant valoir que les pièces convoitées leur ont été cédées de manière légale, même si, dans la réalité, ce n’est pas toujours le cas. Utilisant un autre argument, elles expliquent aussi qu’elles sont investies d’une vocation universaliste non nationaliste, et qu’elles assurent une mission d’intérêt public en préservant des éléments du patrimoine de l’humanité. Le débat se situe donc à un “carrefour entre le droit, la politique et la morale” , ce qui ne manque pas de le rendre particulièrement délicat et conflictuel.
Souvent liée à des enjeux géopolitiques sous-jacents, la restitution de biens culturels n’épargne pas le domaine des livres et des manuscrits. C’est ainsi que la France et la Corée du Sud se disputent la conservation des manuscrits royaux de Corée (ci-dessous) qui, détenus par la BNF, font l’objet d’une affaire à rebondissements sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir dans un prochain billet.

Autre sujet de discorde, la propriété des Neuf couronnes de Damas est revendiquée par la Syrie où ces manuscrits étaient conservés jusqu’en 1993, tandis que l’État hébreu les garde à Jérusalem comme des “trésors du peuple juif qui ont une importance historique, religieuse et nationale”. Dans le même temps, Israël doit également faire face à des revendications de la Jordanie et des autorités palestiniennes sur les fameux Manuscrits de la mer Morte.
Bien des litiges actuels trouvent leur origine dans l’histoire militaire et coloniale des nations. Nombreux sont en effet les pays qui, sous domination étrangère, ont vu des biens et des œuvres d’art quitter leur territoire dans des circonstances suffisamment douteuses et inéquitables pour que leurs gouvernements soient fondés, aujourd’hui, à contester la validité du titre de propriété des détenteurs actuels. Le cas des frises du Parthénon est un des cas les plus anciens et les plus emblématiques dans le genre, puisque cela fait presque 200 ans que la Grèce réclame le retour des sculptures exposées au British Museum ; ce à quoi s’oppose la Grande-Bretagne en s’appuyant sur un document officiel des autorités ottomanes qui gouvernaient alors le pays. De même, Pékin s’efforce d’obtenir la restitution des objets qui ont été pillés en 1860 lors du sac du Palais d’été, et se trouvent désormais dispersés de par le monde dans de multiples collections. C’est à l’un de ces conflits d’origine “coloniale”, beaucoup moins connu et médiatisé, que nous allons nous intéresser ici. Depuis de nombreuses années, il met aux prises deux pays européens, l’Islande et le Danemark, quant à la propriété de manuscrits anciens de la collection baptisée « arnamagnéenne », par référence à un nommé Arni MAGNUSSON.
Une riche collection de documents patiemment collectés
À partir du XIIIe siècle, la grande île septentrionale d’Islande appartient au royaume norvégien, avant d’intégrer le grand État scandinave constitué en 1397 par l’Union de Kalmar placée sous la domination de la monarchie danoise. Quand la Suède, en 1521, puis la Norvège, en 1814, se séparent du Danemark, l’Islande demeure dans l’orbite de Copenhague jusqu’à la Seconde guerre mondiale. C’est au cours de cette longue période de domination danoise qu’un érudit islandais du nom d’Arni MAGNUSSON (ci-dessous) rassembla une inestimable collection de manuscrits médiévaux.
Né dans l’ouest de l’île, celui-ci entre à l’université de Copenhague en 1683 puis, à la fin de ses études, il devient l’assistant de Thomas BARTHOLIN, archiviste et “antiquaire” royal qu’il aide à traduire des documents rédigés en islandais pour la rédaction de son livre Antiquitates danicæ. Se liant d’amitié avec Matthias MOTH, frère de la maîtresse du roi, haut fonctionnaire et futur lexicographe du danois, MAGNUSSON bénéficie grandement de l’appui de son protecteur pour connaître une belle et rapide carrière administrative puis universitaire. En 1702, il est envoyé en Islande pour y effectuer le premier recensement d’une population qui, à l’époque, n’excède pas les 50 000 âmes. Il y est également mandaté pour dresser un inventaire des ressources du pays et entreprendre le premier cadastre de l’île. Mais, à côté de ces missions officielles, notre érudit a dans l’idée d’en remplir une autre, plus personnelle : collecter tous les manuscrits anciens qu’il pourra dénicher.
L’Islande qui, pour l’ancienne Scandinavie, joue le rôle d’un véritable conservatoire linguistique et littéraire, abrite en effet de nombreux livres, tels les Eddas et les Sagas, qu’elle est seule à posséder. Ces ouvrages, qui sont des sources inestimables pour connaître la mythologie et la civilisation des Vikings, attisent la convoitise des savants, des érudits et finalement des autorités danoises. En 1685, un décret royal interdit de vendre à des étrangers ces manuscrits rares, dont beaucoup ont déjà quitté l’île, comme le Codex Regius et le Flateyjarbók. Philologue, historien et géographe, MAGNUSSON se trouve également être un bibliophile de longue date à la tête d’une belle collection de textes islandais, dont certains sont issus de celle de son ancien mentor BARTHOLIN, tel le précieux Möðruvallabók .
Une quête patiente et minutieuse
MAGNUSSON débarque en Islande porteur d’une lettre royale intimant à chacun de lui donner accès à tous les écrits qu’il souhaiterait consulter. Muni de son sésame, il se rend donc chez les particuliers, dans les hameaux et les fermes les plus reculés, à la recherche de documents oubliés. Il se heurte à bien des difficultés car, dans cette contrée pauvre aux conditions de vie très difficiles, beaucoup de manuscrits sur parchemin ont souvent été réutilisés comme doublures dans les vêtements afin de lutter contre le froid. Sa démarche intrusive n’est pas bien accueillie par une population qui ne lui facilite pas la tâche, au point d’alimenter des calomnies à son encontre et même de le contraindre à affronter un procès en adultère.
Pendant dix années, notre homme poursuit patiemment sa quête, reconstituant des ouvrages feuille à feuille, achetant ce qu’il lui est possible d’acquérir et réalisant des copies du surplus. Revenu à Copenhague, il charge son neveu de continuer les recherches dans l’île et de lui expédier ses trouvailles périodiquement. Il enrichit également sa collection en écumant les ventes aux enchères et en acquérant les manuscrits de l’historien Thormodus TORFAEUS. Au terme de sa vie, MAGNUSSON aura rassemblé dans sa maison près de 2 500 manuscrits de toutes sortes (un échantillon ci-dessous), dont le plus ancien remonte au début du XIIe siècle. Pour être complet, ajoutons également qu’il a pris soin de rassembler des milliers de chartes et de diplômes en provenance de la Scandinavie tout entière.

Parallèlement à ses diverses fonctions officielles à l’université et aux archives royales, il travaille sur ses manuscrits dans le but d’en réaliser un catalogue complet et de publier certaines de ses pièces les plus précieuses. Malheureusement, au cours du mois d’octobre de l’année 1728, l’incendie qui ravage la capitale danoise détruit une partie de ses documents, dont un grand nombre de ses livres imprimés. Malade et très affecté par cette perte, MAGNUSSON meurt le 7 janvier 1730. Par testament, il lègue sa collection à l’université de Copenhague, qui l’intègre à sa bibliothèque. Au cours des siècles suivants, le fonds sera enrichi par des achats ou des dons, en particulier par les manuscrits possédés par Rasmus RASK, qui seront mis en vente après sa mort. En 1760, la Fondation arnamagnéenne (Det Arnamagnæanske Legat) est créée pour assurer la conservation et l’étude de cette importante ressource.
En 1874, l’assemblée islandaise, l’Althing, jusqu’alors consultative, se voit doter de compétences élargies. Un nouveau pas vers l’autonomie est franchi avec un amendement en octobre 1903, qui institue un gouvernement local ; de sorte qu’en 1918 le royaume d’Islande, tout en partageant le même roi que le Danemark, est officiellement créé. Profitant de l’occasion pour réclamer le retour au pays de ses “trésors nationaux”, l’Althing lance bientôt une pétition pour demander le retour des manuscrits en langue islandaise de la collection arnamagnéenne. En 1927 et 1928, quatre manuscrits et 700 chartes et documents divers sont rapatriés à Reykjavik dans les archives nationales. Occupée pendant la guerre par les alliés – le Danemark est occupé par les nazis en avril 1940 – l’ïle accède à l’idépendance le 17 juin 1944 et devient une république. Les négociations se feront désormais entre deux états souverains partageant un passé commun. En prévision de restitutions futures, un Institut des études islandaises est fondé en 1962 dans la capitale, avant que ne soit signé, en 1965, un traité entérinant le partage du fonds entre les deux pays. Est considéré comme un “bien culturel islandais”, toute œuvre composée ou traduite par un Islandais et dont le contenu est entièrement ou principalement consacré à l’Islande, définition assez large qui laissait déjà présager des batailles d’experts et de longues procédures.
Le 21 avril 1971, le retour sur l’île de deux manuscrits majeurs, le Flateyjarbók et le Codex Regius, est l’occasion d’une cérémonie très solennelle (ci-dessous).
https://www.youtube.com/watch?v=5aUbGoK1zhsLes restitutions se succèdent ensuite entre 1973 et 1997, permettant à l’Islande de posséder 1666 pièces de la bibliothèque arnamagnéenne, auxquelles s’ajoutent 141 ouvrages issus de la Bibliothèque nationale danoise, ainsi que des chartes rédigées en islandais. Copenhague détient pourtant toujours une bonne partie de la collection de MAGNUSSON en islandais, en particulier les textes qui ne concernent pas directement l’Islande, des copies et des traductions. En 2009, l’Unesco classe l’ensemble de la collection arnamagnéenne, désormais répartie entre deux pays, patrimoine mondial de l’humanité.
Mais l’Islande maintient ses revendications officielles sur certaines œuvres conservées au Danemark. La question sera ainsi remise sur le devant de la scène, en septembre 2019, par la ministre islandaise de l’enseignement et de la culture, Lilja ALFREDSDOTTIR. Son pays demandera alors officiellement à récupérer une part plus importante de la collection, annonce qui coïncidera avec la construction programmée d’un nouveau bâtiment destiné à abriter des manuscrits médiévaux. Mais le monde universitaire et savant des deux nations se divise sur la légitimité et l’utilité de la démarche, plusieurs de ses membres défendant le maintien du système actuel de coopération entre les deux Instituts. Le professeur DRISCOLL rappelle que “ce ne sont pas des objets qui ont été obtenus illégalement ou volés. Arni était le propriétaire de ses manuscrits, qu’il avait soit reçus soit achetés, et il les a légués tout à fait légalement à l’université de Copenhague” ; il incite les autorités islandaises à s’intéresser plutôt aux autres manuscrits qui, dispersés de par le monde, n’ont été ni numérisés, ni étudiés en détail. De nouvelles négociations sont toujours en cours entre les deux pays, sans que rien sur la teneur des discussions n’ait filtré jusqu’ici.
Pour en savoir plus sur cette affaire nordique, nous vous proposons d’écouter cette émission de la série La Fabrique du savoir, diffusée sur France Culture ; de lire cet Article de L’Express du 9 novembre 2019 et de visionner la vidéo ci-dessous…